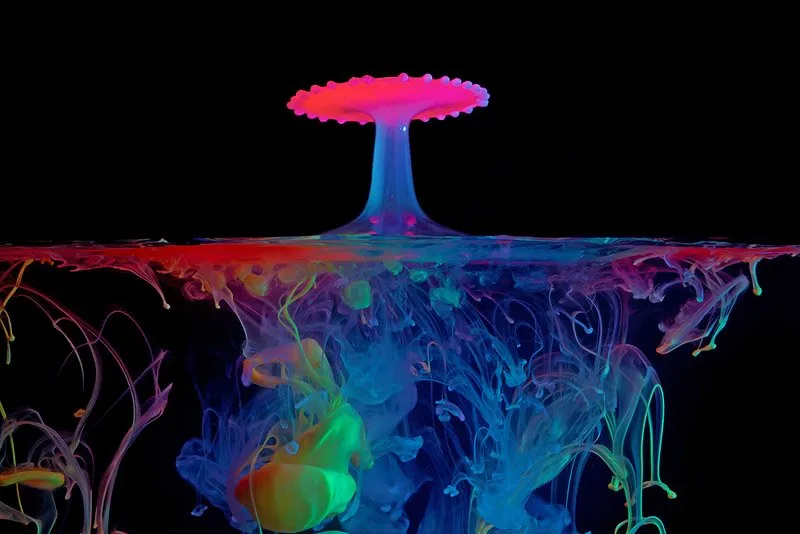Portrait d’Antoine Madrigal : du fanzine Nineteen à la création d’un magasin de disques
Pas de culture sans ceux qui nous permettent d’y accéder. Depuis les années 90, Armadillo est un magasin de disques ouvert au 32 rue Pharaon, à Toulouse. Son allure singulière rappelle en bien des aspects celui d’High Fidelity, roman de Nick Hornby. Peu importe à quelle heure de la journée vous y entrez, vous risquez d’y apercevoir Antoine Madrigal, dit Tatane, au cœur d’une discussion des plus enrichissantes avec l’un de ses clients. Avec sincérité et bienveillance, il a accepté de répondre à toutes mes questions. Découvrez le parcours d’un passionné de rock, son rapport à l’art et plus généralement ses réflexions sur le monde qui l’entoure. Que vous acquiesciez ou non avec sa vision des choses, son authenticité, j’en suis certaine, ne vous laissera pas indifférents.
Comment en êtes-vous arrivé à la création d’Armadillo ?
J’aimais la musique, enfin le rock. J’ai toujours été intéressé par le rock, depuis mon adolescence. Parce que pour toute une génération de gens comme moi, c’était la bande son d’une rupture. On rêvait d’un autre monde. On avait les pieds dans la boue et comme disait un copain, il faut trouver un équilibre entre avoir les pieds dans la boue et la tête dans les nuages. Il dit, que la tête dans les nuages ça finit mal et que les pieds dans la boue, on s’ennuie. Même si c’était des disques et tout ça, ça représentait autre chose que le mode de vie dominant, soit “métro, boulot, dodo”. C’était l’horizon d’être, autant que possible, maître de notre vie.
Dans les années 80, il y a eu un sursaut avec le punk, ça a ouvert des portes énormes. Il y avait toute une scène qu’on aimait et dont personne ne parlait. Alors on s’est dit qu’on allait le faire et de fil en aiguille, on a organisé des concerts, fait de la radio et puis un fanzine, Nineteen. Au bout d’un moment mon copain a arrêté, moi j’ai continué et puis j’ai arrêté aussi. Je me suis dit que j’avais fait le tour, j’avais l’impression de piétiner et il fallait laisser la place aux jeunes générations. Quand on a arrêté, Benoît et moi, on s’est dit : qu’est-ce qu’on va faire maintenant ? Avec mes études d’histoire, je pouvais faire prof, mais je voulais pas. Alors on a continué dans la logique et on a monté un magasin de disques. On n’avait pas d’argent. On l’a construit nous-mêmes jusqu’au système électrique, d’ailleurs ça se voit [rires].


Aujourd’hui, qu’est-ce que ce lieu représente pour vous ?
Le magasin ? Deux choses, dans le désordre : la première c’est pour manger. La deuxième, c’est pour transmettre une certaine culture. Mais il y a une ambiguïté. Aujourd’hui, est-ce je propage vraiment une culture ou ne suis-je qu’un vulgaire commerçant qui vend des marchandises ? On a fait découvrir beaucoup de choses à beaucoup de gens, c’est vrai. Mais je me demande si ça aurait pu être pareil en les rencontrant ailleurs. Déjà à l’époque de Nineteen, on était partisans des marges. Les gens pensaient qu’on faisait ça par snobisme, mais pas du tout. On s’intéressait aux groupes qui préféraient manger des pâtes avec du beurre et faire ce qu’ils voulaient, plutôt que ceux qui voulaient aller dans des restaurants chics et passer à la télé. Parce que derrière, il y avait quelque chose qui nous plaisait et qui nous touchait davantage.

Si tout était à refaire, vous changeriez quelque chose ?
Honnêtement, je ne sais pas. Mais je n’ai aucun regret. J’aurais aimé être riche et éviter de travailler, mais c’est la vie comme on dit [rires]. Comme le disait Machado : “Il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant”. Plus tard, quand tu regardes le chemin que tu as parcouru, tu t’aperçois que ce n’est pas forcément celui que tu t’imaginais. Mais qu’il soit bon ou mauvais, il n’est pas meilleur qu’un autre. C’est le tiens, c’est tout.
À l’inverse, de quoi êtes-vous particulièrement fier ?
De mon fils.
Après, j’ai été fier de prendre part à l’effervescence de ce qu’on appelait, l’underground. J’ai vécu mon adolescence après la révolte politique de 68, mais je trouvais que quelque chose manquait à ces idées-là. J’ai trouvé dans le rock, tout ce qui, pour moi, manquait partout ailleurs. Même s’il n’y avait pas de discours philosophique, cette manière d’être là me plaisait. Peut-être que c’était une illusion, une excuse, que je me donnais pour en faire partie. Mais ça, ça m’a rendu fier.
Comment diriez-vous que l’art a impacté votre vie ?
J’ai découvert l’art en lisant des bouquins. Je détestais l’art. J’avais l’impression que les riches profitaient de la misère et du besoin de manger des artistes pour accrocher des tableaux chez eux. C’était pour les riches et ça ne me plaisait pas. Mais par l’intermédiaire de mes lectures, j’ai découvert d’autres choses et d’autres gens. Ils disaient qu’il fallait regarder dans tout ce qui était, le fragment humain et le fragment de radicalité qu’il pouvait y avoir. Ils citaient plein d’artistes et je me disais : “ah ouais”. A partir de là, je me suis intéressé aux mouvements artistiques, qui exprimaient autre chose que l’acceptation du présent. [À ceux qui avaient la tête dans les nuages ?] Voilà ! Comme peintre par exemple, on ne peut pas dir qu’il exprime la joie de vivre, mais j’adore El Greco. Je lui trouve quelque chose de commun avec certains groupes, comme Le Gun Club.
La littérature occupe une place importante dans votre vie ?
Je suis fils de prolétaire. Mon père, qui était espagnol, a quitté l’école à 12 ans et ma mère savait à peine lire et écrire. Pour toute une tranche de cette génération, la lecture était importante pour apprendre et pour s’émanciper. Pour les milieux modestes, la révolte passait aussi par la culture. Quand j’étais jeune, je me suis pris une claque en lisant Vaneigem. Je trouvais sa façon d’aborder la révolution espagnole particulièrement crédible, il la décrivait comme on me l’avait racontée. Aujourd’hui, je te citerais Gary Snyder, j’ai un grand respect pour lui et ses livres me plaisent.
Quel a été votre premier coup de cœur artistique ?
Au début, comme tous les jeunes, je lisais “Salut les copains” [1]. Ils avaient fait un article sur Woodstock et je trouvais ça extraordinaire que 500 000 personnes se retrouvent. J’avais 14 ans et à partir de là, les premiers disques que j’ai achetés c’était Led Zeppelin, les Beatles et les Who. J’ai eu la chance de connaître quelqu’un de plus grand que moi, qui m’a branché sur plein de choses moins connues et puis j’ai fait mon propre chemin. De manière générale, ça a toujours été le rock. Mais en fonction des époques, un peu le psyché ou ce qu’on appelait le “real rock” dans les années 80. C’était des groupes qui jouaient sans synthétiseur, qu’avec des guitares. Puis le new psyché, le garage et le punk rock.
Êtes-vous davantage attaché aux courants et aux œuvres de votre jeunesse ?
Je les écoute, mais sans plus. Dans les années 80-90, il y a des disques qui m’ont surpris et que j’ai adoré. Sur le moment, dès qu’un disque sortait, tu achetais des 45 ou des 33 tours et ça faisait partie de l’effervescence. Quand tu fais quelque chose d’activiste, il faut que tu sois passionné, c’est la moindre des choses. Mais avec le recul, tu t’aperçois qu’il n’y a que les disques importants qui restent.
Le problème, c’est qu’on n’avait pas le temps de tout voir et qu’on jugeait le reste par rapport à ce qu’on aimait. On ne s’intéressait pas aux groupes qui étaient apparentés à d’autres mouvements, alors qu’on aurait pu les adorer. Le groupe R.E.M. était vachement bien pour ça, parce qu’ils jouaient avec le mec des Smiths. Alors que pour moi, les Smiths, ils faisaient la couverture des Inrockuptibles et Morrissey était bien habillé, il avait les cheveux courts, propres. Il ressemblait à tout ce que je voulais détester. Paradoxalement, on reprochait aux gens de s’attacher aux images et de ne pas aller derrière, mais je m’aperçois que nous, on pouvait faire pareil. Quand des copains en qui j’avais confiance m’en parlaient, il pouvait m’arriver de faire des exceptions, mais je ne l’aurais pas fait de moi même. On voulait être partie prenante, mais avec le recul, je me dis que même par rapport au rock, il y a des choses qu’on a manquées. Maintenant que je ne cherche plus à l’être, j’écoute des disques que je n’écoutais pas à l’époque.
Dû à votre métier, vous vous êtes penché sur d’autres choses ?
Par curiosité, je jette une oreille et tout ça. Mais ça reste culturel. J’ai un profond respect pour le hip-hop par exemple. Musicalement ça ne me plaît pas, ça ne me touche pas. Mais j’aime la démarche underground du hip-hop, je peux m’y retrouver. Le rock n’a pas le monopole de l’expression d’autre chose. Les surréalistes, les romantiques, les dadas, eux aussi, refusaient le monde dans lequel ils étaient.

En 2021, Rolling Stone affirmait que la vente de vinyles ne s’était plus aussi bien portée depuis 30 ans. C’est une tendance toujours actuelle, qu’en pensez-vous ?
Les vinyles sont devenus ringards et on en trouvait moins à une époque, mais on en a toujours vendus. Il y a certaines choses que les gens préfèrent écouter en vinyle. Il faut avoir du bon matériel, mais le son est meilleur et l’avantage, c’est que ton approche de la musique est différente. Quand tu écoutes un vinyle, tu dois rester à côté, parce qu’il faut changer de face tous les quarts d’heure. Tu es beaucoup plus concentré, tu es là. Alors qu’un CD, tu le mets, il s’arrête, tu rappuies et hop il repart. La musique devient un fond sonore. Le problème avec cet effet de mode, c’est que les gens achètent des vinyles comme ils pourraient acheter n’importe quels autres objets. Il y a eu une étude en Angleterre, un tiers des vinyles achetés ne sont pas écoutés. D’un côté, il y a un intérêt pour le vinyle et c’est purement personnel, mais ça ne me plaît pas que les gens en achètent sans les écouter. Le second problème, c’est que depuis que le vinyle est redevenu à la mode, on ne trouve plus certains disques. Les majors qui ont récupéré le catalogue des petits labels n’ont pas réédité tous leurs petits groupes, ça ne les intéressait pas. Alors à part les originaux qui valent une fortune, il y a des disques que tout un public d’amateurs éclairés ne trouve plus. Par exemple, tu vois ce qui passe là ? “Ain’t It Good”, c’est un morceau de Grapefruit, un petit groupe des années 60. Ils ont sorti ce disque chez Répertoire, un label allemand et aujourd’hui tu ne le trouves plus. En soi ce n’est pas grave, mais c’est la cerise sur un gâteau qui n’est vraiment pas bon.
Quel est votre rapport à l’art contemporain ?
L’indifférence totale. Je pourrais m’y intéresser, mais je n’ai pas les clés pour le découvrir. Alors j’en ai une vision générale, celle que nous donnent les médias et la télévision. A l’époque déjà, des étudiantes que je connaissais m’avaient proposé d’aller voir les Impressionnistes, à Paris. J’ai trouvé ça extraordinaire ! Pourtant, de moi-même je n’y serais jamais allé. Je les voyais comme des aquarellistes du dimanche, alors que derrière il y avait tout autre chose. C’est une question d’opportunités. Les découvertes se font de fil en aiguille je crois, en lisant un bouquin ou un article, tac, tu tombes là et etc.
Selon vous, pourquoi l’art occupe une si grande place dans nos réflexions, nos discussions et plus largement dans notre vie ?
Pour compenser le manque de vivre, le manque de vivre une vie pleinement. Il faudrait déjà savoir laquelle… La vie telle qu’on nous la propose se réduit souvent à la consommation et donc au besoin d’aller travailler, pour avoir de l’argent et pouvoir consommer. Le truc serait de prendre un autre chemin et là, chacun se le voit, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Parce que c’est pas évident et ça l’est encore moins pour les jeunes d’aujourd’hui. Nous on râlait contre le monde dans lequel on était, mais c’était plus facile de passer au travers des gouttes. On a très peu travaillé, on n’avait pas d’argent, on faisait des boulots comme ça ou on était au chômage. On se déplaçait en stop mais quand on allait voir un endroit, c’était pour le découvrir, pas pour vérifier si ce qu’on avait vu sur internet était vrai. Je dis peut-être ça parce que je suis vieux, mais je crois que beaucoup de choses sont en train de tomber. Ça ne veut pas dire que le fait de vouloir changer le monde n’existe plus, mais la forme n’est pas la même. Il y a de nouvelles façons de l’énoncer et de l’exprimer. Nous quand il y avait des rockeurs on avait l’impression que c’était le monde entier, mais en fait, quand on faisait des concerts il y avait 200 personnes. On n’était pas nombreux, mais on avait l’impression de l’être parce qu’autour de nous, tout le monde pensait que ça allait changer. Je crois que maintenant c’est pareil pour les jeunes générations. J’ai l’impression qu’il ne se passe rien parce que je suis extérieur à tout ça, mais ce n’est pas vrai.
Pour répondre à ta question, nous aussi on essayait de trouver des réponses là où on le pouvait et je sais que dans l’art, il y en a.
On a terminé, voulez-vous ajouter quelque chose ?
Non, voilà. On est loin du magasin de disques.

Pour se replonger au cœur de l’effervescence, Antoine a publié Nineteen : anthologie d’un fanzine rock. Deux volumes, un premier sur la scène internationale et un second sur la scène française, aux éditions Fondeurs de brique, en 2016. Cette démarche incarne pour lui la transmission d’un savoir rare au sujet de certains groupes et de leurs histoires, que l’on ne raconte pas toujours alors qu’ils sont chers à cette culture.
Prolongement écrit de l’émission radio du même nom, lancée en 1962. ↩︎